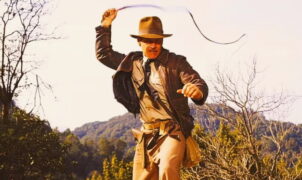CRITIQUE DE FILM – Sur le papier, le nouveau long métrage d’Osgood Perkins, L’Élue, a tout du petit huis clos horrifique autour d’un tueur en série : retrait dans une cabane perdue au milieu des bois, couple en bout de course, signes avant-coureurs inquiétants, folie qui s’infiltre plan après plan. À l’écran, le résultat ressemble pourtant davantage à un long collage de cauchemars, où l’atmosphère, les images étranges et la bande-son fonctionnent souvent mieux que le récit lui-même. Certaines scènes vous glacent réellement le sang, mais l’ensemble donne surtout l’impression que le réalisateur de Longlegs et de The Monkey a renversett sur nous le mix de visions horrifiques qui tourne dans sa tête, en nous laissant seuls avec la mission de leur trouver un sens. Nous avons découvert L’Élue au cinéma Puskin, à Budapest.
Ces dernières années, Osgood Perkins s’est patiemment imposé comme l’une des voix les plus reconnaissables du cinéma d’horreur contemporain : Longlegs avait déjà des allures de film culte au stade de la promotion, tandis que The Monkey tordait suffisamment la nouvelle de Stephen King pour ne pas ressembler à une simple adaptation de commande. Ses mises en scène reposent en général sur une atmosphère dense et angoissante, un rythme volontairement lent et une psychologie sombre, tangible, à laquelle il ajoute par moments des effets presque théâtraux, assumés comme tels. Pas étonnant que les bandes-annonces de L’Élue nous aient vendu un trip « psychédélique » en cabane au fond des bois, où la frontière entre réalité et hallucination se dissoudrait progressivement.
Au centre du film, on trouve Liz (Tatiana Maslany) et son compagnon Malcolm (Rossif Sutherland), qui partent fêter leur première année de relation dans la maison de vacances de la famille de ce dernier. La situation de départ est familière à tout amateur de films d’horreur : une maison isolée en apparence idyllique, un couple où les non-dits et les doutes sont nettement plus nombreux que ce que les intéressés veulent bien admettre, et ce malaise diffus qui se répand peu à peu partout. Dans les premières minutes, Perkins joue habilement avec ces attentes, mais donne parfois le sentiment de ne jamais vraiment choisir entre le thriller tendu et le pur film de sensations oniriques. L’Élue passe constamment d’un registre à l’autre sans trouver un véritable équilibre.
Un film d’horreur expérimental qui se défait en chemin
L’Élue assume clairement son statut de film d’horreur expérimental : Perkins ne s’appuie pas sur le schéma classique du « on traque le tueur », mais sur le jeu formel, les coupes inattendues et les associations d’images éclatées. Sur le principe, la démarche est plutôt séduisante – ce type de film est censé représenter ces tentatives courageuses et risquées qui promettent de dire quelque chose de neuf dans un genre surexploité. Le problème, c’est qu’une bonne partie de ces ambitions expérimentales reste, en pratique, plus intrigante que réellement convaincante.
L’un des rares contre-exemples récents, le The House de Kyle Edward Ball, reposait lui aussi sur un récit fragmenté, mais touchait à quelque chose de radicalement étrange qui poursuivait le spectateur bien après la séance. L’Élue, lui, ne trouve jamais ce point d’étrangeté suffocante qui vous force à scruter les coins sombres de la pièce avant d’aller vous coucher. On y voit défiler des idées, des motifs, des effets de style, sans que l’ensemble ne produise cette sensation d’inquiétante familiarité qui fait la force des meilleurs films d’horreur expérimentaux.
Un huis clos de couple dans une cabane au fond des bois
Pourtant, le film démarre sur une séquence d’ouverture suffisamment réussie pour donner un temps l’espoir que Perkins tient ici quelque chose de vraiment marquant. Du strict point de vue du protagoniste masculin, nous voyons défiler un montage des femmes avec qui il est déjà sorti, puis qu’il a quittées – comme un journal intime en accéléré, où le même schéma vient se répéter encore et encore. Au fur et à mesure que le puzzle se recompose, c’est une expérience sociale très familière qui apparaît : celle de cet homme qui ne reste fidèle que jusqu’à la prochaine « grande histoire d’amour ». Le portrait qui se dessine a quelque chose de profondément paradoxal, en écho ironique à l’expression « tueur en série » : dès qu’il y a de la série dans le comportement de quelqu’un, mieux vaut se méfier.
C’est à partir de ce prologue que nous basculons vers l’histoire de Liz. Tatiana Maslany, que l’on suit depuis longtemps avec attention depuis la série Orphan Black, incarne ici une femme intelligente, citadine, un peu paumée, prête à célébrer son anniversaire de couple avec Malcolm. Celui-ci l’invite dans la maison de campagne familiale, qu’il appelle modestement une « cabane », alors qu’il s’agit en réalité d’un chalet en bois spacieux, rénové, aux finitions élégantes. Grandes baies vitrées, volumes ouverts, forêt tout autour : tous les éléments sont réunis pour donner l’impression d’être entré sur un plateau de film d’horreur, dans le décor rêvé de quelqu’un qui voudrait faire disparaître une victime sans laisser de traces.
Le personnage de Malcolm, lui, ne facilite pas vraiment l’idée que l’on puisse se détendre. Médecin, fermé, peu souriant, il est interprété par Rossif Sutherland avec une gravité morose et une sorte de passivité monocorde qui mettent mal à l’aise. Barbe fournie, réponses laconiques, énergie renfrognée : on a du mal à imaginer ce type se laisser aller à la moindre spontanéité ou à un élan de tendresse sincère. Le spectateur, comme Liz, ne peut s’empêcher de se demander ce qu’elle trouve à ce compagnon – et le film appuie précisément là-dessus, en nous convainquant que tout a l’air normal en surface, alors que chaque geste, chaque silence semble renfermer une autre vérité. Dans une Amérique saturée de sarcasme, l’austérité un peu trop droite de ce Canadien finit par ressembler à un signal d’alarme en soi.
Une part de gâteau, et le cauchemar se détraque
Très vite, Malcolm sort à Liz la phrase la plus suspecte du manuel : « tu n’es pas comme les autres filles ». Il n’en faut pas plus pour que l’on se prépare au pire. On s’attend alors à suivre pas à pas la descente aux enfers d’un tueur en série, mais le film bifurque brusquement. C’est à ce moment que déboule le cousin de Malcolm, Darren, un « bro » inquiétant que Birkett Turton joue comme la version déglinguée d’un ex-animateur télé. Il arrive accompagné d’un mannequin d’Europe de l’Est, Minka (Eden Weiss), qui ne parle quasiment pas anglais et lâche, en désignant le gâteau déposé par le gardien de la maison, un laconique « ça a un goût de merde ».
Pris isolément, ce genre de détail relève d’un réalisme assez cru que l’horreur contemporaine affectionne. Sauf que le jugement de Minka va se révéler étrangement bancal. Plus tard, Malcolm propose à Liz une part de ce fameux gâteau au chocolat, qu’elle goûte dans une scène montée pour faire monter la tension, et qui s’avère, à en juger par sa réaction, parfaitement comestible. En revanche, au milieu de la nuit, Liz descend à la cuisine et dévore littéralement tout ce qu’il en reste. C’est à partir de là que semblent se déclencher les visions : silhouettes humaines grisâtres, quasi fantomatiques, ex-petites amies au visage de cadavre, Minka qui se dédouble en une version plus petite d’elle-même, comme un clin d’œil aux jumelles de Shining, et même un flash-back absurde, situé deux siècles plus tôt, où les cousins enfants abattent dans les bois une femme enceinte qui ressemble trait pour trait à Liz.
Après cette montée en régime, Malcolm repart en ville, appelé auprès d’un patient, et Darren réapparaît, cette fois pour aller chercher dans la cuisine un énorme couteau de boucher. Tous les signaux convergent vers lui comme possible tueur en série que le film nous laissait deviner jusque-là. Mais la scène ne débouche sur rien. L’Élue semble prendre un malin plaisir à tendre les nerfs du spectateur, puis à couper le fil sans jamais offrir de véritable conséquence à ces moments. Au bout d’un certain temps, la peur laisse place à une forme de fatigue : on ne tremble plus vraiment, on espère simplement que ce que l’on voit finira par signifier quelque chose.
Belles images, concept qui se délite
Visuellement, il n’y a pourtant pas grand-chose à reprocher à L’Élue. La photographie de Jeremy Cox compose un univers de forêts, de bois et de pénombre très travaillé, souvent élégant, nettement plus maîtrisé que le torrent d’idées visuelles parfois brouillon de Longlegs ou de The Monkey. Vu depuis la salle, le film ressemble toutefois à près de deux heures de « essayons de comprendre ce que tout cela veut bien dire ». Aux clichés du cinéma de tueur en série – têtes plongées dans des liquides visqueux, corps dissous dans des substances improbables, réservoirs nauséabonds – s’ajoute une mythologie confuse, à peine esquissée, que le récit présente comme un commentaire plus profond sur la peur masculine de l’engagement.
Les choix musicaux vont aussi dans ce sens : quand résonnent « I Don’t Want to Play in Your Yard » de Peggy Lee, « Love Is Strange » dans la version de Mickey & Sylvia ou encore « Fooled Around and Fell in Love » d’Elvin Bishop sur le générique final, tout indique que Perkins voudrait filmer le point de rencontre entre l’homicide et la lâcheté affective, là où l’incapacité à choisir, la fuite devant la responsabilité et la tendance à transformer l’autre en objet commencent à faire des dégâts. Le problème, c’est que cette idée ne prend jamais vraiment corps à l’écran. L’Élue dit surtout une chose : Osgood Perkins lui-même semble incapable de s’engager dans un langage de cinéma cohérent, préférant courir après le « prochain truc cool » qui lui passe par la tête et plaquer chaque inspiration de passage sur la même histoire.
-Herpai Gergely BadSector-
L'Élue
Direction - 6.2
Acteurs - 7.1
Histoire - 5.3
Visuelité / Ambiance horrifique - 7.2
Ambiance - 6.4
6.4
CORRECT
L'Élue part d’une idée prometteuse et offre un film d’horreur souvent fort sur le plan visuel et atmosphérique, mais dont le concept se délite peu à peu, au point que les images de cauchemar restent en tête alors que le récit, lui, s’efface vite. Il s’adresse surtout à celles et ceux qui aiment les films d’atmosphère lents et expérimentaux, et qui acceptent que la logique ne soit présente qu’à moitié dans l’histoire. En revanche, le spectateur qui attend un thriller de tueur en série tendu, construit et cathartique risque de quitter la salle avec l’impression que quelqu’un a laissé le film d’horreur en plan et ne s’est appliqué qu’à terminer le décor.