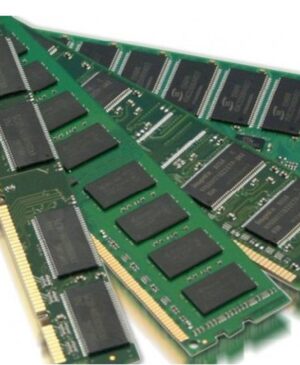CRITIQUE DE SÉRIE – Steven Knight n’a pas rangé ses ambitions en même temps que Peaky Blinders : au lieu de poser le verre, il continue de puiser dans l’Histoire comme dans une pinte bien fraîche, et cette fois, il nous sert une grande saga familiale irlandaise à la mousse bien sombre. House of Guinness se boit comme une stout parfaitement tirée : les premières gorgées rappellent des terrains familiers, entre rues poisseuses et costumes impeccables, mais le goût qui reste en bouche est celui de l’argent, du pouvoir et d’un privilège héréditaire difficile à avaler. Pour ceux qui erraient encore avec un verre vide depuis la fin de Peaky Blinders, Knight ouvre un autre bar, dans une autre ville, avec un nouveau clan et une dose tout aussi généreuse de musique, de style et de drame humain très sale.
Depuis la conclusion de Peaky Blinders en 2022, Knight est loin d’avoir ralenti. Le scénariste-showrunner a enchaîné les projets aux tonalités très différentes : les origines des forces spéciales britanniques dans Rogue Heroes, la scène musicale de Birmingham dans les années 1980 avec This Town, les combats à mains nues de l’ère victorienne dans A Thousand Blows, ou encore les jeux d’ombres contemporains des services secrets dans The Veil. Toutes ces séries portent sa patte – sens du cadre, goût pour les familles abîmées, tension quasi mythologique –, mais aucune n’avait vraiment retrouvé ce sentiment de grande chronique criminelle familiale, enfumée et rampante, qui habitait la saga des Shelby. Du moins jusqu’à aujourd’hui.
Mousse irlandaise et querelles familiales façon Peaky
À bien des égards, House of Guinness ressemble à un retour spirituel de Knight vers son œuvre la plus célèbre. On y suit une famille blessée, vaniteuse et perpétuellement en compétition, dont chaque membre cherche à contrôler le pouvoir, l’influence et le récit de sa propre légende, tandis que Dublin – et non plus Birmingham – est filmée comme un personnage à part entière. Le scénario enracine les luttes intimes des protagonistes dans les réalités sociales, économiques et politiques de l’époque, ce qui donne un mélange très dense de mélodrame familial, de luttes de pouvoir et de fresque historique solide.
La violence n’a pas disparu du menu, et la bande-son se montre aussi délicieusement anachronique que dans Peaky Blinders, comme si l’on projetait des guitares et des batteries modernes sur un Dublin du XIXe siècle encore couvert de suie. Les costumes, manteaux et chapeaux haut-de-forme pourraient à eux seuls alimenter une exposition, tant chaque tenue est pensée comme une armure de cinéma. Sur le plan social, les Guinness évoluent à des années-lumière des tripots et bas-fonds des Shelby : ils partent avec des châteaux, une brasserie tentaculaire et un patrimoine indécent, pas avec un bureau de paris miteux. Mais moralement, leurs dents sont tout aussi acérées, simplement mieux dissimulées par un décor doré qui rassure les bonnes consciences.
Pour autant, la série n’est pas une photocopie, plutôt une cousine issue de la branche noble de la famille. Elle s’appuie sur des figures historiques réelles et sur une marque connue dans le monde entier, et elle mélange habilement manœuvres capitalistes, intrigues parlementaires, philanthropie très publique, rivalités internes, liaisons sentimentales vouées au désastre et scandales méthodiquement dépecés par la presse. Les comparaisons avec Succession de HBO n’ont donc rien d’exagéré : on reste dans ce territoire où les héritiers font tout pour mériter – ou fuir – leur nom.
Aucun personnage n’est aussi opaque ou ravagé intérieurement que Tommy Shelby, mais chaque membre du clan Guinness traîne derrière lui un secret, une honte ou un désir soigneusement refoulé. L’une des grandes questions de la série est de savoir si ces personnes peuvent exister autrement que comme produits de leur nom, de leur fortune et de leur naissance, ou si elles sont condamnées à rester enfermées dans l’étiquette que la société leur colle.
Un testament qui cogne plus fort qu’une pinte sur le crâne
L’intrigue se déroule principalement à Dublin et assume pleinement son identité irlandaise. Le récit s’ouvre en 1868, à la mort de Benjamin Lee Guinness, petit-fils du fondateur Arthur Guinness. C’est lui qui a transformé l’entreprise familiale en véritable empire et fait de la brasserie de St. James’s Gate l’une des plus grandes du monde. Il laisse derrière lui une fortune colossale, et la première question, très concrète, qui se pose à la famille est celle de son partage entre ses quatre enfants : Arthur (Anthony Boyle), héritier théorique, mais manifestement peu intéressé par Dublin comme par les affaires ; Edward (Louis Partridge), idéaliste et bourreau de travail qui rêve de propulser encore plus loin la marque Guinness ; Benjamin (Finn O’Shea), épave ambulante dont le taux d’alcoolémie semble permanent ; et Anne (Emily Fairn), sœur pragmatique et pilier discret, que les hommes relèguent sans cesse au second plan alors qu’elle est, en pratique, le véritable centre de gravité du clan.
À la lecture du testament, les intentions de Benjamin Lee Guinness apparaissent dans toute leur brutalité. Arthur et Edward sont condamnés à diriger la brasserie à deux : ils n’ont d’autre choix que de travailler ensemble, et s’ils veulent s’en dégager, ils doivent renoncer à l’intégralité de leur héritage. Benjamin, que le père juge incapable de gérer le moindre capital, est cantonné à une allocation mensuelle scrupuleusement contrôlée. Quant à Anne, considérée comme relevant désormais de la « responsabilité » de son mari, elle se retrouve quasiment sans liquidités et ne peut utiliser certains domaines familiaux que si Arthur donne son accord. (Spoiler : le patriarche n’a rien d’un vieux gentil au grand cœur.)
On ne s’étonnera donc pas que les quatre frères et sœurs accueillent la nouvelle avec colère, humiliation et ressentiment. À partir de là, la série raconte comment chacun est obligé de se plier à la volonté paternelle d’outre-tombe, et comment ils découvrent que cet héritage n’est pas seulement une question de prestige et de richesse, mais aussi un ensemble très concret de contraintes, de chaînes et de sacrifices.
Nation, sobriété et alcool de famille
House of Guinness a l’allure d’une grande fresque en manteaux lourds et ruelles enfumées, mais ne cesse de revenir à des moments humains beaucoup plus intimes. Pendant qu’Edward élabore des stratégies pour faire couler la bière Guinness sur le plus de tireuses possible aux États-Unis, Arthur tente de s’installer dans le siège de député laissé vacant par son père, et Anne commence, avec prudence mais détermination, à redorer le blason du nom Guinness grâce à des actions caritatives choisies avec soin. L’Irlande de la seconde moitié du XIXe siècle fournit quantité de menaces extérieures : un mouvement de tempérance de plus en plus bruyant, en guerre ouverte contre l’industrie qui nourrit la famille ; des tensions croissantes entre l’élite protestante prospère et la population catholique pauvre ; et un mouvement nationaliste, incarné par les Fenians, qui cherche la moindre brèche pour se débarrasser de la tutelle anglaise.
C’est pourtant lorsque la série se recentre sur les poisons qui circulent à l’intérieur de la maison qu’elle se révèle la plus percutante. Ces frères et sœur s’aiment et se détestent dans la même phrase, recalculant sans cesse qui a encore sa place dans l’empire et qui n’est plus qu’un poids mort. Le regard de l’opinion, l’attention des journaux, l’exposition politique et les clivages religieux fonctionnent comme autant d’amplificateurs de leurs rancœurs. Ironiquement, c’est peut-être Benjamin qui se montre le plus honnête : il ne prétend jamais être meilleur qu’il n’est, affiche au grand jour ses penchants autodestructeurs, pendant que les autres cachent les leurs sous des visages impeccablement repassés.
Le casting est, soyons clairs, une réussite. Anthony Boyle semble taillé pour le costume d’époque, il porte le haut-de-forme et la redingote comme s’ils avaient poussé avec lui, et son Arthur oscille avec finesse entre aristocrate suffisant, jouisseur, et figure tragique dont le vernis se fissure lentement. L’homosexualité de l’aîné est un secret de Polichinelle au sein de la famille, et même lorsque Arthur se marie, lui comme son épouse savent parfaitement à quel type d’arrangement ils consentent et selon quelles règles leur vie commune va fonctionner.
Boyle et Louis Partridge forment un duo de frères d’une grande souplesse, capable de changer de tonalité à vue. Au fil des huit épisodes mis à disposition, Arthur et Edward passent leur temps à se hurler dessus, à supplier, à se faire du chantage, à négocier, puis à fonctionner comme un duo soudé digne d’un « Goodbye Earl » revisité en costume trois-pièces. Cette relation en perpétuelle évolution est l’un des piliers de la série. Parallèlement, même si la famille sous-estime constamment Anne, Emily Fairn emporte presque chaque scène dans laquelle elle apparaît : elle est lucide, déterminée, et prête à tout pour laisser une trace dans un monde qui tente systématiquement de l’effacer. Benjamin, lui, reste étonnamment sous-exploité, en tant que personnage comme en termes de présence à l’écran, ce qui laisse à Finn O’Shea un espace de jeu frustratoirement réduit.
Hauts-de-forme, drapeaux et taux d’alcool dans le rouge
Autour de ce quatuor central gravite une galerie de seconds rôles très solide. James Norton semble s’amuser comme un fou en Rafferty, homme de main promu factotum de la famille : contremaître respecté parmi les ouvriers, mais aussi bras armé que l’on envoie régler les problèmes, de préférence à coups de poings. Danielle Galligan, que beaucoup ont découverte dans Shadow and Bone, est irrésistible en Olivia, l’épouse d’Arthur, femme moderne, ambitieuse et délicieusement ironique, qui accepte ce mariage atypique à ses propres conditions, qu’elle a définies jusque dans le moindre détail.
Niamh McCormack, dans le rôle de la leader républicaine Ellen Cochrane, donne un visage et une épaisseur émotionnelle à la lutte pour l’indépendance irlandaise, tandis que Jack Gleeson campe le relais de la famille sur le marché américain, personnage aussi gluant que réjouissant, spécialiste de la flatterie intéressée. Michael McElhatton, majordome épuisé jusqu’à la corde, vole plusieurs scènes par de simples regards et petits gestes, qui résument mieux qu’un long dialogue ce que signifie servir une famille dont chacun veut tout, tout de suite.
La seconde moitié de saison vacille un peu. Quelques ellipses temporelles et intrigues compressées diluent par moments la tension, et certains fils narratifs secondaires s’intègrent moins bien que d’autres à l’ensemble. Malgré cela, House of Guinness sait tellement bien ce qu’elle veut être qu’elle encaisse sans trop de casse ces irrégularités. La série reste obstinément concentrée sur la famille, revenant sans cesse à la même idée : les choix insensés, impossibles, parfois franchement stupides que ces personnages sont prêts à faire lorsque leurs envies, ambitions et peurs se heurtent à ce que leur nom est censé représenter.
Au terme du dernier épisode, il est difficile de ne pas avoir envie de « reprendre un verre » en compagnie de ce clan à la fois toxique et étrangement attachant. Si Peaky Blinders était le whisky fumé et coupant de Knight, alors House of Guinness est sa stout : plus mousseuse, plus ronde, toujours assez amère pour laisser une marque, qui se boit lentement et ne plaira pas à tout le monde dès la première gorgée, mais qui risque bien de devenir un réflexe pour ceux qu’elle accroche.
-Gergely Herpai “BadSector”-
House
Direction - 8.5
Acteurs - 8.6
Histoire - 8.7
Visuels/Musique/Sons - 9.2
Ambiance - 8.4
8.7
EXCELLENT
House of Guinness est une grande saga familiale irlandaise qui mélange politique, affaires et drame intime dans une même pinte généreuse, sans jamais oublier la tension qui bouillonne sous la mousse. Les spectateurs en manque de personnages marquants, de manteaux qui claquent au vent et d’anti-héros moralement ambigus façon Peaky Blinders pourraient bien y trouver leur nouvelle obsession. La série n’est pas exempte de faiblesses, notamment dans son rythme, mais elle reste de celles pour lesquelles on n’hésite pas à commander une tournée supplémentaire en attendant la prochaine saison.