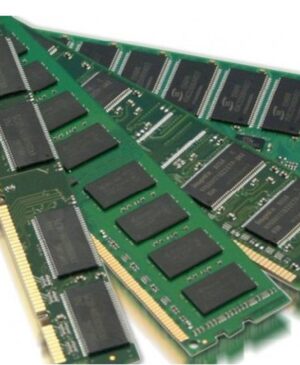CRITIQUE – Le roman dystopique de Stephen King, The Running Man, imagine un monde où un jeu télévisé sadique transforme la lutte pour gravir l’échelle sociale en spectacle baigné de sang. La version cinématographique de 1987, réalisée par Paul Michael Glaser, est sortie bien avant l’ère de la téléréalité triomphante, tandis que l’adaptation de 2025 signée Edgar Wright arrive à un moment où même le « leader du monde libre » peut avoir grandi dans l’écosystème des émissions de téléréalité. Ce qui passait autrefois pour une prophétie glaçante ressemble désormais à un avertissement ressassé : le nouveau film de Wright n’ajoute pas grand-chose à notre époque, il se contente surtout de se brancher sur ce qui l’environne déjà.
Le cinéaste britannique émousse presque totalement la charge politique du récit de King. En surface, le film parle le langage de la révolution, avec ses banderoles qui flottent et ses slogans scandés dans la rue, mais il reste désespérément flou sur l’objet réel de cette révolte. Lorsque retentit le morceau emblématique de Gil Scott-Heron, The Revolution Will Not Be Televised, il fonctionne davantage comme une plaisanterie sèche et cynique que comme un appel aux armes, d’autant qu’on l’a entendu récemment sur le générique de fin de One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Wright maintient la satire et le commentaire à un niveau très bas, tout en jonglant avec les mots-clés – surveillance, propagande, manipulation médiatique – jusqu’à ce qu’ils se dissolvent dans un paquet de paranoïa aussi sûr que générique.
Une révolution réduite à un simple décor
Dans ces États-Unis d’un futur proche, le gouvernement, les forces de l’ordre et une chaîne publique devenue organe de propagande scellent une alliance étroite qui engendre un système où le pouvoir est théoriquement partout, mais nulle part vraiment saisissable. Ben Richards, interprété par Glen Powell, est un père de famille issu des classes populaires, doté d’un instinct de rébellion, qui ressent la pression du système dans sa chair sans savoir vraiment où diriger sa colère. Sa radicalisation est dessinée de manière si vague et diffuse que le public reçoit au fond le même message : s’installer confortablement, ne pas trop chercher à comprendre ce qui devrait l’indigner.
Acculé et désespéré à l’idée de financer les soins de sa fille gravement malade, Ben se porte candidat à l’émission-titre. Dans ce monde, « The Running Man » est un véritable phénomène monoculturel, un programme qui aspire tout sur son passage et fait ressembler le chaos actuel des plateformes de streaming à un simple bruit de fond. Pendant trente jours, il doit survivre aux chasseurs professionnels et aux citoyens chauffés à blanc qui le prennent pour cible, sous l’œil constant de caméras qui retransmettent en direct la traque à un public captivé. Comme le résume crûment le producteur chevronné Dan Killian (Josh Brolin), si Ben tient ne serait-ce qu’une semaine à l’antenne, sa famille se retrouve propulsée dans le fameux « top 1 % » de la société.
Une téléréalité où le public peut se contenter de s’affaler
Le postulat de King suffirait à lui seul à porter un long métrage. Wright et son scénariste régulier Michael Bacall, avec lequel il avait déjà coécrit Scott Pilgrim vs. the World, bâtissent avec assurance les règles du jeu, la galerie de chasseurs et tout le cirque télévisuel qui les entoure. Un film intitulé The Running Man promet d’emblée une action nerveuse et soutenue, domaine dans lequel Wright excelle depuis ses années indé du début des années 2000. Les premières poursuites et les premiers affrontements tiennent cette promesse : montage serré, décors urbains bien cadrés, quelques trouvailles visuelles qui rappellent fugacement la patte du réalisateur.
Mais les signes de fatigue apparaissent étonnamment tôt et finissent par étouffer un troisième acte asphyxié. Ben Richards est progressivement enfermé dans des impasses scénaristiques toujours plus absurdes, dont il ne peut sortir qu’à coups d’explosions supplémentaires ou de rebondissements laborieux fondés sur le deepfake. À chaque séquence d’action réellement efficace répond un développement de l’intrigue qui en annule l’impact et en réduit l’intensité. Wright semble craindre que pousser ses idées jusqu’au bout ne fasse fuir le grand public ; il privilégie donc à répétition le compromis prudent, choisissant la solution la plus sûre plutôt que la plus audacieuse.
Un film d’action calibré pour le popcorn, une critique sociale timorée
Le réalisateur et son acteur principal ont parfaitement compris la « commande » : livrer un film de science-fiction spectaculaire, lisible, facile à consommer, qui n’introduit la noirceur de King qu’à petites doses, juste assez pour piquer la curiosité sans gâcher le confort du spectateur. Le problème, c’est que Wright et Powell abordent le projet avec une discipline et un professionnalisme tels qu’ils diluent précisément ce qui fait leur singularité. Très conscients de leur propre « marque », ils la plient avec tant de précaution aux attentes du genre que le résultat ressemble à un produit de studio avers au risque, poli jusqu’à l’uniformité.
Sur le papier, le rôle avait pourtant tout du rêve pour Glen Powell. Après un passage remarqué dans Top Gun: Maverick et un premier rôle partagé dans Twisters, il a connu l’une des ascensions hollywoodiennes les plus commentées de ces dernières années, et The Running Man lui offre enfin l’occasion de porter seul sur ses épaules une grosse production de studio. Mais le Ben Richards écrit ici a tout d’un manteau de seconde main : à distance, il semble taillé pour lui, et plus on s’en approche, plus on voit qu’il baille de partout.
Glen Powell, meilleur lorsqu’il se dissimule
Ce personnage repose trop sur des éclats de rage grimés, la mâchoire serrée, et pas assez sur les moments de légèreté et de charme qui ont fait la cote de l’acteur. Powell cherche manifestement comment donner du poids aux scènes où Ben apparaît usé, endurci, mais les instants réellement marquants n’arrivent qu’une fois qu’il retrouve la rue et que le « jeu » de l’émission commence vraiment. Dès que les règles l’obligent à se fondre dans la foule sous différentes identités, réapparaît cette dimension de caméléon déjà entrevue dans Hit Man.
Parcourant la ville en costumes colorés et ironiques, essayant tour à tour divers rôles sociaux, il semble prendre un plaisir évident au méta-jeu de son propre métier. Paradoxalement, Powell paraît le plus authentique lorsque le film lui demande d’incarner quelqu’un de tout autre. Par opposition au modèle classique de la star, qui décline de film en film une même persona, l’acteur s’efforce de briser ce schéma – mais ce long métrage ne sait pas toujours comment structurer un véritable arc autour de cette envie.
Edgar Wright, au service du studio plus que de lui-même
Sur le plan des aptitudes physiques, rien ne manque : Powell court, est projeté contre les murs, se bat au corps à corps, et la scène d’évasion obligée, tournée avec lui en simple serviette, prouve qu’il n’a pas délaissé la salle de sport. Le véritable problème tient au fait que le film peine à créer des situations où cette présence corporelle et son humour malicieux pourraient fonctionner de concert. Le scénario de Wright et Bacall lui offre bien quelques répliques efficaces, mais le ton général des dialogues reste souvent calé sur le registre plus rugueux, fait de punchlines, de l’interprétation originelle d’Arnold Schwarzenegger – un registre qui sonne étrangement décalé dans la bouche de Powell.
La colère de Ben Richards, née d’un sentiment d’injustice sociale, se resserre peu à peu en un arc de vengeance beaucoup plus classique, et Powell peine à trouver ce point d’équilibre où cette fureur garderait malgré tout une forme d’attrait. Puisque le personnage est censé canaliser la frustration du public – un miroir dans lequel les spectateurs projettent à la fois leur image et leur rage contre le système –, ce déficit de magnétisme affaiblit considérablement les enjeux du film. Difficile, dans ces conditions, de croire que ce Ben ferait exploser les courbes d’audience.
Ce qu’on pourrait encore attribuer à des « maladies de jeunesse » pour une star montante est nettement plus difficile à pardonner à Edgar Wright. Ici, le cinéaste renonce presque entièrement à l’excentricité visuelle, au sens du rythme et au jeu pop qui ont fait de Baby Driver, de Shaun of the Dead ou de Scott Pilgrim vs. the World des objets de culte. Le budget probablement à neuf chiffres, qui devrait constituer un jalon majeur dans sa carrière, ressemble davantage à un carcan : Wright apparaît comme un artisan de studio fiable mais prévisible, chargé de livrer des scènes d’action propres, conformes au cahier des charges.
Un film qui se contente d’être « suffisamment bon »
Au bout du compte, c’est presque uniquement la présence de Michael Cera – clin d’œil en coin aux années Scott Pilgrim – qui laisse entrevoir ce que ce récit aurait pu devenir dans un film de Wright réellement libre et formellement aventureux. Le réalisateur tente bien de compenser le manque de fantaisie visuelle par un casting malin et une série de petits gags – Colman Domingo, William H. Macy et Lee Pace sont tous à leur meilleur niveau –, mais ces apparitions restent des éclats de couleur plus que de véritables trajectoires mémorables.
De la même manière que le monde de Ben Richards finit par se heurter au plafond de ce que le spectacle peut offrir comme diversion, The Running Man atteint sa propre limite. Le film est solidement construit, parfois vraiment divertissant, à l’occasion même acéré, mais il exploite rarement jusqu’au bout le potentiel politique et stylistique qui est à sa portée. Wright se satisfait d’un film « bon », alors qu’il dispose de tous les ingrédients pour s’imposer parmi les meilleures adaptations de King. À la place, il tourne en rond sur le terrain sans jamais vraiment marquer.
– Gergely Herpai “BadSector” –
The Running Man
Direction
Acteurs
Histoire
Visuels/Musique/Sons/Action
Ambiance
MÉDIOCRE
Cette nouvelle version de The Running Man est spectaculaire et par moments vraiment amusante, mais elle traite la critique sociale inscrite dans le roman de Stephen King avec des gants de velours. Glen Powell prouve qu’il peut assumer les exigences physiques d’un premier rôle d’action, mais la version plus sombre et renfermée de Ben Richards qu’on lui confie ne laisse jamais vraiment s’exprimer pleinement son charisme naturel et joueur. Edgar Wright, de son côté, met en grande partie de côté la flamboyance visuelle et le style personnel de ses premières œuvres, et il en résulte une relecture solide, mais loin d’être mémorable, d’un classique du genre.