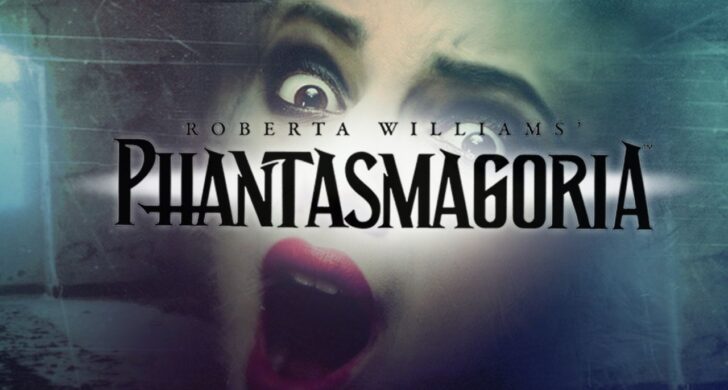RETRO – Au milieu des années 90, les jeux vidéo ont commencé à rattraper le cinéma – pas seulement en termes de gameplay, mais aussi dans leur narration, leur mise en scène et leur capacité à immerger les joueurs. L’arrivée du CD-ROM a ouvert la voie aux jeux en prises de vue réelles, et c’est dans ce contexte qu’est né Phantasmagoria : un film d’horreur interactif qui, même trente ans plus tard, reste capable de retourner l’estomac.
À l’époque, sur consoles, des titres comme Metal Gear Solid ou Final Fantasy VII faisaient l’effet d’une bombe, grâce à leurs cinématiques impressionnantes et leur narration digne des plus grands films. Mais bien avant eux, avec l’essor du CD-ROM, une nouvelle tendance avait émergé : des jeux tentant de reproduire l’expérience cinématographique en utilisant de véritables séquences vidéo. Des titres comme Sewer Shark, The 7th Guest ou Night Trap ont suscité l’engouement – ou la controverse – mais celui qui m’a le plus marqué, c’est bien Phantasmagoria. Je me souviens encore de l’avoir acheté pendant mes années d’étudiant, avec un sourire en coin en découvrant qu’il était même annoncé dans le Népszabadság. L’impact est resté, même si les détails se sont estompés avec le temps. Aujourd’hui, trente ans plus tard, j’ai décidé de le ressortir du placard pour voir comment il se comporte en 2025. Et puis, soyons honnêtes : sa bande-son déchire toujours autant.
Un projet de rêve devenu un cauchemar sanglant
Derrière Phantasmagoria, on retrouve la légendaire Roberta Williams de chez Sierra On-Line, célèbre pour la série King’s Quest. Elle caressait cette idée de jeu d’horreur depuis huit ans, attendant simplement que la technologie soit à la hauteur de ses ambitions. Le résultat : un script de 550 pages, clairement inspiré par Stephen King et Edgar Allan Poe. Elle a réuni 25 acteurs pour donner vie au projet. Le budget initial était de 800 000 dollars, mais il a explosé pour atteindre 4,5 millions – dont 1,5 million uniquement pour le studio construit par Sierra spécialement pour le tournage.
Le jeu est sorti sur sept CD, et a engrangé 12 millions de dollars dès son premier week-end – devenant ainsi l’un des plus gros succès de l’année. Pourtant, malgré ce succès commercial, les critiques ont fusé. Beaucoup y voyaient l’exemple parfait des dérives du genre FMV : jeu d’acteurs grotesque, énigmes d’une simplicité enfantine et intrigue digne d’un téléfilm de seconde partie de soirée. Mais le véritable scandale est venu d’ailleurs : le jeu contient des scènes de meurtre ultra-violentes en prises de vues réelles – et surtout une scène de viol explicite – ce qui a conduit plusieurs distributeurs à le boycotter totalement.
Stephen King, The Shining, et un démon pour couronner le tout
Dès les premières minutes, l’ambiance évoque du Stephen King pur jus – et plus précisément The Shining – avec, bien sûr, une protagoniste écrivain. Adrienne et son mari Don emménagent dans un vieux manoir isolé près d’un petit village côtier, sans se douter que la maison cache un passé bien plus sombre qu’il n’y paraît. En incarnant Adrienne, on explore les couloirs de cette demeure labyrinthique, on découvre des passages secrets… et, bien sûr, on libère par mégarde un démon, autrefois invoqué par l’illusionniste du XIXe siècle, Zoltan “Carno” Carnovasch. Ce démon finit par posséder Don, qui sombre lentement dans la folie et devient de plus en plus violent.
Ce qui m’a frappé en y rejouant, c’est la lenteur assumée du rythme – dans le bon sens du terme. L’histoire est découpée en sept journées, une par CD, et les trois premières servent uniquement à explorer le manoir, à comprendre les lieux et à faire connaissance avec les personnages. Les énigmes ne présentent pas une grande difficulté, et c’est très bien ainsi : cela permet de s’immerger pleinement avant que l’horreur ne prenne le dessus. Aujourd’hui encore, rares sont les jeux qui osent prendre leur temps – et c’est justement cette montée en puissance progressive qui fait tout le charme de Phantasmagoria.
Point & click sanglant et intuitif
Le système de jeu est un point-and-click classique, mais avec une interface aux allures gothiques : une bordure en pierre encadre l’écran, affichant constamment l’inventaire et plusieurs boutons de fonction. On retrouve une icône en forme d’œil pour examiner les objets, et un crâne rouge pour obtenir des indices. Ce dernier est essentiel, car les développeurs voulaient manifestement éviter que les joueurs abandonnent à cause d’un casse-tête abscons. Leur but était clair : que tout le monde puisse aller au bout… et frissonner en chemin.
Évidemment, quelques passages à la logique tordue typique des jeux d’aventure de l’époque sont au rendez-vous – ces fameux moments « WTF ?! » où rien ne te prépare à la solution attendue. Malgré tout, l’ensemble reste fluide. J’ai utilisé une soluce de temps en temps (je n’ai pas honte), mais je cliquais parfois sur le crâne juste pour le plaisir d’écouter la voix off ridiculement dramatique qui te guide. C’est kitsch ? Oui. Et alors ? C’est génial.
Fond vert, CGI et frissons old-school
Explorer le manoir est un véritable plaisir, en grande partie grâce à la direction artistique. Phantasmagoria mélange des acteurs filmés en live-action avec des décors générés par ordinateur. Aujourd’hui, cela peut sembler daté, mais en 1995, c’était une prouesse technique. Voir des acteurs interagir avec des objets invisibles dans des décors numériques crée une ambiance étrange, mais incroyablement efficace. Je me suis surpris à repenser au gamin de 11 ans que j’étais, bouche bée devant un tel spectacle. Même les animations les plus banales – Adrienne qui s’assoit sur un canapé ou s’allonge sur un lit – étaient impressionnantes à l’époque. Et il y en a plein, preuve que l’équipe a porté une attention méticuleuse aux détails.
Les meurtres, eux, valent leur pesant d’hémoglobine. Réalisés par une boîte d’effets spéciaux nommée The Character Shop, ils sont volontairement excessifs. Une femme dont la tête est tranchée par une lame suspendue. Une autre poignardée en plein visage avec un outil de jardin. Un homme dont la tête s’enflamme. C’est gore, c’est absurde… et c’est jouissif. La scène de la séance de spiritisme, en particulier, est magistrale : elle fusionne parfaitement prises de vues réelles et CGI. Et les artefacts de compression des vidéos FMV renforcent encore la brutalité des scènes. Phantasmagoria, c’est du pur délire horrifique des années 90 – et j’adore ça.
Un nanar assumé… et irrésistible
Soyons clairs : le scénario ne tient pas toujours debout. Don et Adrienne emménagent dans un manoir immense, avec des ailes condamnées, une salle de torture, un vieux berceau décrépi… et personne ne semble s’en formaliser. Pas de serrurier, pas d’exorciste, pas même un hôtel en vue. Juste eux et leur déni. Les personnages secondaires ne sont pas en reste : un agent immobilier lourd et sexiste, un homme lent d’esprit censé faire rire… Des archétypes franchement douteux aujourd’hui. Et pourtant, ça fonctionne. On se croirait dans une mini-série Stephen King des années 2000 – maladroite, sincère, et paradoxalement attachante malgré ses défauts.
Trente ans plus tard, le frisson est toujours là
Il est rare de rejouer à un jeu 30 ans après sa sortie et de ressentir encore quelque chose. Mais Phantasmagoria réussit ce tour de force. C’est une capsule temporelle qui capture autant le génie que les maladresses de l’ère FMV. Si je gardais surtout en mémoire la violence, j’ai été surpris de redécouvrir une histoire touchante, celle d’une femme piégée dans une relation de plus en plus abusive, dans une maison hantée, sous l’influence d’un démon.
Si tu aimes le kitsch, l’horreur rétro et les expériences qui n’ont pas peur de franchir les lignes rouges, Phantasmagoria vaut encore largement le détour. Que ce soit pour la nostalgie ou pour la curiosité, attache ta ceinture. Tu n’en ressortiras pas indemne.
– Gergely Herpai “BadSector” –