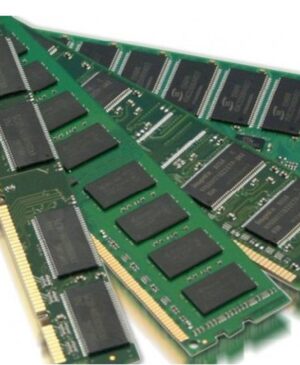CRITIQUE DE SÉRIE – À première vue, Absentia ressemble à « une énième série du FBI avec tueur en série », où tout s’articule autour d’une agente disparue et d’un milliardaire plus que suspect. Après quelques épisodes, on comprend pourtant que l’histoire est bien plus personnelle et nettement plus sombre: le drame d’une femme brisée, d’une famille éclatée et d’un système où le traumatisme ne se referme jamais vraiment, il se rouvre sans cesse. Au fil de ses trois saisons, Absentia glisse progressivement du thriller procédural classique vers le cauchemar psychologique et le complot à l’échelle mondiale, tout en gardant en permanence le visage marqué d’Emily Byrne dans l’objectif, et à travers lui nos propres peurs.
La situation de départ se suffit déjà à elle-même: Emily Byrne, agente du FBI à Boston, disparaît alors qu’elle traque un tueur en série qui mutile les paupières de ses victimes. On ne retrouve jamais son corps, mais son mari Nick, leur fils Flynn et leurs collègues finissent par lâcher prise, le deuil ayant aussi une date d’expiration dès lors que l’administration a tamponné le dossier « déclarée morte ». Six ans plus tard, on extirpe d’une citerne rouillée une femme à moitié morte, qui ne se souvient presque de rien mais qui est bel et bien vivante: Emily revient dans une vie qui, entre-temps, s’est réorganisée sans elle.
La première saison d’Absentia joue habilement avec ce manque. Non seulement Emily ignore qui l’a torturée et pourquoi, mais elle doit aussi affronter le fait que son mari a refait sa vie, qu’une nouvelle épouse, Alice, élève son fils et que sa propre maison appartient, émotionnellement, à quelqu’un d’autre. L’un des fils les plus forts de la série est justement ce drame familial tragiquement ordinaire: que faire d’un revenant que l’on a déjà pleuré, en étant persuadé qu’il ne franchira plus jamais le pas de la porte?
L’agente disparue et le milliardaire suspect – les enjeux de la première saison
Sur le plan policier, la saison d’ouverture démarre sur un schéma en apparence très classique. Le tueur responsable des victimes retrouvées sans paupières, les autorités pensent l’avoir identifié en la personne de Conrad Harlow, excentrique richissime au regard glacé, qui coche toutes les cases du bingo du serial killer. Mais quand Emily est libérée et que des corps méthodiquement mutilés réapparaissent, plus rien n’est aussi clair. Si Harlow est derrière les barreaux, qui tue à l’extérieur? S’il n’était pas le coupable, qui a fait subir tout cela à Emily? Et s’il l’était malgré tout, comment peut-il continuer à tuer depuis sa cellule?
Tout au long de cette première saison, la série fait vaciller la confiance du spectateur. D’un côté, nous voyons Emily, dont chaque geste crie qu’elle est une victime qui a trop souffert, de l’autre, l’enquête criminelle laisse régulièrement planer le doute sur le fait qu’elle n’a peut-être pas été seulement un pion passif dans cette histoire. Tommy Gibbs, flic de Boston cramé mais lucide, la surveille de biais, tandis que le FBI la traite comme un témoin mis sur la touche mais potentiellement dangereux, quelqu’un dont on a besoin sans jamais croire totalement à ce qu’il dit.
Les contorsions de crédibilité, entre l’agente qui semble pouvoir s’échapper à volonté du service et piétiner tous les protocoles, et la liste de suspects qui enfle de manière parfois improbable, poussent par moments le récit dans la catégorie « d’accord, passons là-dessus ». Mais Absentia fonctionne encore à ce stade parce que l’Emily de Stana Katic reste profondément humaine derrière chaque rebondissement trop chargé: une femme qui essaie en même temps d’être enquêtrice, mère et survivante, sans jamais pouvoir véritablement entrer à l’aise dans aucun de ces rôles.
Expériences, démons et Moldavie – le second cercle plus sombre de la saison 2
La deuxième saison fait d’emblée un choix courageux: elle refuse de rejouer le même tour de piste autour de la question « qui est le tueur? ». Elle préfère disséquer ce qu’il reste d’un être humain soumis pendant des années à des expériences psychologiques et médicales. Emily est officiellement de retour au FBI, mais sa manière de travailler tient toujours plus du commando improvisé que de l’intervention réglementaire. Elle dort mal, prend de mauvaises décisions, avance souvent portée par la colère et la peur, bref, on voit enfin que le traumatisme n’a pas disparu sous prétexte que l’héroïne a récupéré son badge.
Les nouvelles affaires, de plus en plus tordues et sadiques, finissent toutes par ramener à la même source: ces expériences inhumaines pratiquées autrefois sur Emily. C’est là qu’entre en scène Cal Isaac, le nouveau partenaire, qui ressemble d’abord au cliché du « dur à cuire » militaire mais qui se révèle, au fil des épisodes, hanté par au moins autant de démons qu’Emily. Leur relation est intéressante justement parce qu’elle n’a rien d’un réconfort romantique, c’est une alliance fragile entre deux êtres cabossés, ponctuée de faux pas et d’échecs.
Au sein du FBI, de nouveaux visages tirent aussi les ficelles: Julianne Gunnarsen, profiler qui est à la fois la supérieure d’Emily et un regard extérieur constamment sceptique, et le docteur Semo Oduwale, thérapeute éminent dont les méthodes flirtent dangereusement avec les horreurs du passé. À un moment, l’intrigue quitte Boston pour filer vers la Moldavie, où la traque se transforme enfin en véritable action-thriller sous haute tension, avec poursuites, opérations coup de poing, ruelles étroites et décisions dont on ne revient pas en se contentant de rédiger un rapport de mission.
Le rythme de cette deuxième saison est plus lent au départ, il prend son temps avant de vraiment mordre. En échange, une question traverse en permanence le récit: jusqu’où peut-on excuser quelqu’un sous prétexte qu’il « n’a fait qu’obéir aux ordres » lorsqu’il a expérimenté sur des êtres humains? Pour Emily, ce n’est pas un débat théorique mais un combat intime, chaque nouvelle victime la renvoyant à ces années de torture qui lui collent encore à la peau.
Trafic d’organes, virus et complot mondial – une troisième saison qui veut tout surpasser
Dans la troisième saison, Absentia dépasse clairement le cadre du « simple récit sur une agente du FBI brisée » et fait monter les enjeux à l’échelle globale. Les migrants retrouvés morts et amputés de leurs organes embarquent très vite Emily, Nick et Cal Isaac dans une affaire où le trafic d’organes n’est qu’une porte d’entrée. En arrière-plan s’alignent expériences pharmaceutiques illégales, créations de virus et intérêts politico-économiques si vastes qu’un dossier du FBI paraît soudain dérisoire.
Flynn, le fils d’Emily et de Nick, a entre-temps énormément grandi. Il n’est plus le petit garçon que tout le monde tentait de protéger mais un ado que les ennemis de sa mère remettent, encore et encore, dans la ligne de mire. Le grand-père, Warren, et l’oncle Jack, qui se bat avec ses problèmes d’alcool, essaient de lui offrir une vie tant bien que mal « normale », alors que la ferme censée être un refuge se transforme régulièrement en théâtre d’affrontements armés. Les proches ne sont plus seulement des appuis affectifs, ils sont les points d’ancrage par lesquels l’histoire de « sauvetage du monde » retrouve un visage humain.
La saison ne craint pas d’en faire beaucoup. Taupes au sein du FBI, milliardaires qui tirent les ficelles en coulisses, organisations criminelles qui menacent avec des virus, tout dessine un monde où le pouvoir ne se préoccupe plus du nombre de vies sacrifiées pour un nouveau médicament ou un avantage économique de plus. Oui, on est parfois dans le registre « acceptons, ne cherchons pas trop la petite bête », et un spectateur aguerri repèrera certains rebondissements bien avant qu’ils n’arrivent. Mais ceux qui restent à ce stade le font moins pour la rigueur logique que pour savoir ce qu’il advient d’Emily et des autres.
Ce qui frappe, c’est que malgré ces enjeux planétaires, la vraie tension continue de se jouer autour des tables de cuisine, dans les conversations chuchotées dans le noir, dans ces instants très courts mais profondément humains. Quand Emily et Nick se disputent pour savoir comment offrir une vie à peu près normale à Flynn après tant de violence, ou quand Cal se montre incapable de se défaire de ses réflexes de soldat, on sent bien davantage ce qui est en jeu que dans n’importe quelle scène de laboratoire.
Stana Katic, héroïne d’action et visage du trauma – ce qui tient vraiment la série
S’il y a bien un point sur lequel on peut coller l’étiquette « ça marche » à l’ensemble d’Absentia, c’est le jeu de Stana Katic. Productrice, elle est présente derrière les choix créatifs, et en tant que tête d’affiche, elle court un marathon émotionnel et physique qui s’étale sur trois saisons. Emily Byrne est à la fois enquêtrice, mère, victime et agresseuse, et la série est au sommet chaque fois qu’elle refuse de compartimenter ces rôles pour les laisser se chevaucher. Dans une scène, elle paraît fragile, au bord de la crise de panique, dans la suivante, elle met quelqu’un à terre à mains nues, et les deux dimensions restent crédibles.
La patte féminine se voit aussi dans la façon dont les personnages secondaires féminins sont traités. Alice n’est pas simplement « la seconde épouse », c’est une figure maternelle dont la vie part, elle aussi, en morceaux lorsque Emily revient. Julianne Gunnarsen n’est pas une « cheffe méchante », mais une agente moralement tiraillée, qui essaie de défendre à la fois les règles et l’humanité. Même les personnages plus discrets, comme la hackeuse Kai, ont droit à assez d’espace pour rappeler que ce monde n’est pas uniquement dirigé par des hommes en costume gris.
En parallèle, la série n’a pas peur d’aller très loin dans le noir. Torture, violence psychologique, traumas de guerre, expériences médicales à la limite zéro de l’éthique, Absentia flirte souvent avec la question « jusqu’où a-t-on envie de regarder tout ça? ». Ce n’est pas toujours élégant, parfois un peu racoleur, à l’occasion la mythologie interne est poussée trop loin, mais l’univers oppressant qu’elle met en place reste cohérent et assumé d’un bout à l’autre des trois saisons.
Combien vaut la vérité si tu perds tout en chemin?
La grande force d’Absentia est sans doute de ramener en permanence les outils classiques du thriller, cliffhangers, valse des suspects, bombes à retardement, à une question profondément humaine: cela vaut-il vraiment la peine de se battre pour la vérité si, en échange, tu sacrifies toutes tes relations, le peu de confiance qui te reste et, au bout du compte, ta santé mentale? Pendant trois saisons, Emily Byrne tourne autour de ce dilemme, en prenant parfois de bonnes décisions, parfois les pires, sans jamais être présentée comme un « modèle positif », plutôt comme une femme qui trébuche sans cesse mais refuse de lâcher prise.
La série est loin d’être parfaite. Certains rebondissements se voient venir, le hasard s’invite un peu trop souvent, la logique se relâche par moments et la troisième saison s’aventure plusieurs pas au-delà de la frontière du vraisemblable. Mais pour celles et ceux qui aiment les thrillers sombres centrés sur les personnages, où l’héroïne est au moins aussi dangereuse pour elle-même que pour ses ennemis, Absentia est un titre résolument addictif. La première saison est plus intime, la deuxième plus focalisée sur le trauma, la troisième, malgré ses excès, fonctionne comme un final plus ample orienté action, et l’ensemble compose une série qui ne réécrit peut-être pas le manuel du genre, mais laisse une empreinte plus profonde que ce qu’on attendrait d’« un FBI-krimi de plus ».
-Gergely Herpai “BadSector”-
Absentia
Direction - 7.4
Acteurs - 7.8
Histoire - 6.8
Musique/audio/action - 8.2
Ambiance - 7.6
7.6
BON
Absentia raconte l’histoire de l’agente du FBI Emily Byrne, qui revient après six ans de captivité et doit affronter une famille brisée ainsi que ses propres traumatismes. Au fil de ses trois saisons, la série passe de l’enquête sur un tueur en série aux expériences psychologiques, au trafic d’organes puis à un complot mondial. Elle n’est pas parfaite, mais en tant que thriller sombre et centré sur les personnages, elle reste franchement addictive pour ceux qui supportent les récits oppressants et émotionnellement éprouvants.