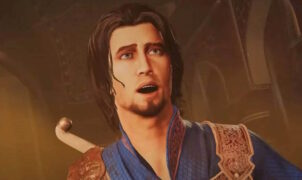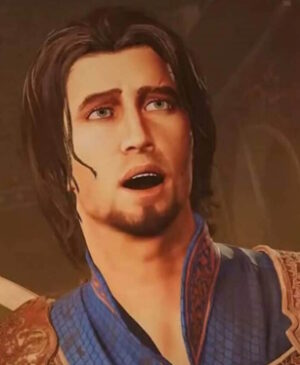ACTUALITÉS TECH – Une ambiance de Nobel, un tournant pour la santé et un partenariat industriel stratégique se sont rencontrés lors de la 13e Journée de l’innovation de l’Université de Szeged. L’événement a été ouvert par le recteur László Rovó, qui a rappelé que le prix Nobel est « dans l’air » à Szeged, puisque l’université a déjà donné quatre lauréats du Nobel à la Hongrie.
Veronika Varga-Bajusz, secrétaire d’État au ministère de la Culture et de l’Innovation, a ajouté qu’aujourd’hui déjà douze universités hongroises appartiennent aux 5 % des meilleurs établissements du monde, et que même dans ce groupe de tête, l’Université de Szeged compte parmi les porte-drapeaux : en 2024, l’établissement a déposé 20 demandes de brevet et 16 demandes d’enregistrement de marque, a acquis 25 nouveaux actifs de propriété intellectuelle, tandis que ses revenus issus de programmes de R&D menés avec les entreprises ont dépassé 2 milliards de forints. Gábor Szabó, président de l’Association hongroise de l’innovation, a souligné que l’on ne peut véritablement parler d’innovation que lorsqu’elle apporte quelque chose de nouveau et des résultats économiques concrets sur le marché, et que pour cela, une forte tolérance à l’échec est indispensable.
L’invitée d’honneur de la journée était la biochimiste Katalin Karikó, lauréate du prix Nobel, qui, dans sa conférence intitulée « De l’innovation à l’application industrielle », a retracé pour le public plusieurs décennies d’histoire de la thérapie à ARN messager : de la découverte fondamentale de 1961 à la synthèse en éprouvette en 1984, des essais cliniques lancés en 2000 jusqu’aux vaccins à ARNm largement utilisés à partir de 2021. Elle a rappelé comment, avec Drew Weissman, elle a mis au point la technique de l’ARNm à nucléosides modifiés, qui empêche l’ARN messager de déclencher une réponse immunitaire excessive, ouvrant ainsi la voie aux vaccins contre le Covid-19 et à d’autres thérapies. Elle a décrit sa carrière comme un long parcours semé d’obstacles, marqué par le manque de financements, les projets refusés et les coûts élevés liés aux brevets, face auxquels il a fallu tenir bon. Pour illustrer la fin de ce chemin difficile, elle a sorti de sa poche sa médaille Nobel, comme un message montrant qu’une simple idée peut réellement devenir une thérapie à l’impact mondial. Elle a aussi mis en garde contre la désinformation, en insistant sur la responsabilité des scientifiques dans la vulgarisation et le dialogue avec le grand public. En parlant d’intelligence artificielle, elle a expliqué qu’elle pose elle-même des questions aux systèmes d’IA, mais qu’à ses yeux, ChatGPT est encore « stupide », donne souvent de mauvaises réponses, et ne peut donc pas remplacer l’expertise professionnelle ni la pensée critique.
Lors de l’événement, la chancelière de l’université, Judit Fendler, a annoncé que l’établissement lançait un projet pilote de dépistage à grande échelle couvrant tout le comitat de Csongrád-Csanád. Le programme reposera sur trois axes : une petite commune rurale (Ruzsa), une ville chef-lieu d’arrondissement (Szentes), ainsi qu’un bus de dépistage itinérant qui recueillera des données pendant cinq ans. Le contexte est alarmant : les indicateurs de santé de la Hongrie restent largement en dessous des moyennes de l’OCDE, de l’Union européenne et des pays de Visegrád. En matière de consommation d’alcool, de tabagisme et d’obésité, le pays se situe nettement au-dessus de la moyenne, tandis que la participation aux programmes de dépistage préventif est extrêmement faible. Seules 30 % des femmes âgées de 50 à 69 ans se rendent à la mammographie (contre 54 % en moyenne dans l’OCDE et plus de 80 % dans les pays nordiques), le taux de participation au dépistage du cancer du col de l’utérus est de 26 %, et celui du dépistage du cancer colorectal n’atteint que 3 %. Fendler a rappelé qu’au maximum 20 % de l’état de santé d’une personne dépendent du système de soins lui-même, tandis que tout le reste est lié au mode de vie individuel et à la prévention.
La signature d’un accord de coopération stratégique entre l’Université de Szeged et Roche Hongrie a également eu lieu lors de la Journée de l’innovation. L’objectif de ce document est que les deux parties soutiennent mutuellement leurs activités de recherche, de développement et de formation, et lancent de nouveaux projets d’innovation communs. La coopération envisagée mettra l’accent notamment sur la neurologie, l’immunologie, l’oncologie, la cardiologie, la diabétologie, les maladies rares, l’ophtalmologie, la biologie médicale et l’anatomie pathologique. Au cœur du partenariat se trouvent des solutions de santé numérique adaptées au 21e siècle, l’amélioration de l’organisation des soins et de la communication entre médecins et patients, ainsi que le renforcement de la prévention, de l’éducation du grand public et de la culture de santé.
L’événement comprenait également la remise des prix de l’innovation de l’Université de Szeged et des lettres de mission du fonds SZTE Proof of Concept 2025, qui ont mis en avant des projets tels qu’une « brique verte », le logiciel éducatif d’évaluation des compétences E-dia ou encore un système de mesure toxicologique basé sur l’intelligence artificielle, autant de développements déjà tournés vers le marché. Selon les dirigeants de Roche, ce nouvel accord n’est pas une simple formalité, mais un exemple de coopération étroite entre un acteur mondial de l’industrie de la santé et une université de recherche de tout premier plan. La Journée de l’innovation à Szeged a ainsi montré à la fois comment les idées peuvent devenir des technologies utiles, comment la recherche universitaire peut se transformer en thérapies appliquées au chevet des patients, et comment un centre régional peut devenir l’un des acteurs clés pour permettre à la population hongroise de vivre plus longtemps et en meilleure santé.