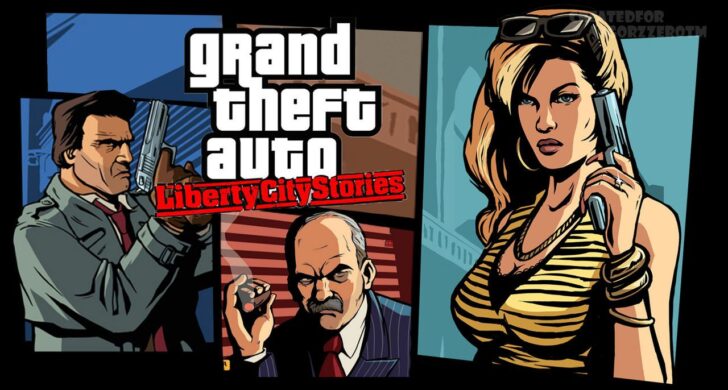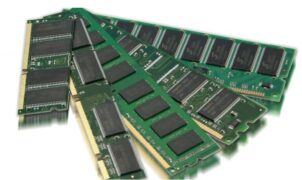RETRO – Bien avant que GTA Online et les polygones à cinq chiffres ne redéfinissent nos repères, Rockstar a tenté un petit miracle: réduire Liberty City au format portable. Grand Theft Auto: Liberty City Stories n’est pas «un épisode de plus» – il nous ramène en 1998, trois ans avant GTA III, et prouve qu’une vraie métropole, crade, bavarde et dopée au talk-radio, peut tenir sur un UMD de PSP. Toni Cipriani y grimpe marche après marche dans la famille Leone jusqu’au galon de caporegime. Vingt ans plus tard, Liberty City Stories cogne toujours.
Sorti à l’automne 2005 en exclusivité sur PSP, le jeu a été porté un an plus tard sur PlayStation 2 avec un prix plus doux – mais sans l’option de «ripper» sa bande-son perso. Après ce tour de piste mi-2000s, petite pause, puis retour « remastérisé » sur mobile: commandes tactiles, textures affûtées, éclairage plus nerveux et distance d’affichage élargie. Le cœur n’a pas bougé: la même Liberty City, figée en 1998 – quartiers en chantier ou en démolition, Callahan Bridge inachevé, et un ferry qui remplace un pont encore fermé. En préquel, le jeu s’emboîte à GTA III comme une photo manquante dans l’album de famille.
Développement et pari du portable (moteur maison, ports, radios et musiques)
Fruit d’un tandem Rockstar Leeds/Rockstar North, Liberty City Stories est le premier GTA 3D sur portable. Pour y parvenir, le studio a lâché RenderWare au profit d’un moteur interne taillé pour la PSP, histoire que densité de textures, particules et résolution ne plient pas la machine. Image Metrics signe les animations faciales, avec une synchro labiale crédible – pas seulement dans les cinématiques, mais aussi dans les habillages visuels des pubs et émissions radio. Côté audio, la recette GTA est intacte: dix stations mêlant licences, compositions maison et joutes verbales savoureuses. Bonus PSP: via l’outil PC «Rockstar Custom Tracks v1.0» (bâti sur Exact Audio Copy), on pouvait injecter ses propres morceaux dans le trafic – une option absente sur PS2 et mobiles.
Le calendrier est limpide: PSP en octobre 2005, port PS2 à l’été 2006 (MSRP plus bas), apparition sur le PSN au printemps 2013 avec compatibilité PS3. Les versions mobiles «boostées» sont arrivées ensuite – iOS en premier, puis Android et Fire OS – avec commandes tactiles, éclairage temps réel, textures HD et horizon repoussé. Le multi ad hoc de la PSP (local, jusqu’à six joueurs, sept modes) reste une petite capsule temporelle: les versions PS2 et mobiles l’ont laissé sur le bas-côté.
Gameplay en 1998 (carte, libertés, limites et petites combines)
LCS, c’est de l’action-aventure en vue à la troisième personne, monde ouvert, sur le plan de GTA III – avec quelques conforts hérités de Vice City/San Andreas: plus d’intérieurs, changement de fringues et – enfin – des motos. La carte est plus ramassée que San Andreas, mais la ville respire: les usines de Portland, les tours de Staunton, l’étalement de Shoreside Vale – tout est là, simplement calibré pour 1998. Le pont de Callahan est en travaux, le ferry fait le lien, et certains quartiers n’ont pas encore le visage de 2001. Fort Staunton commence à l’italienne… jusqu’à ce que le scénario fasse tout sauter, au sens propre.
Les libertés sont celles d’un «grand» GTA compressé. La caméra est plus souple que dans GTA III, mais l’époque et la plateforme posent des bornes nettes. Le héros ne sait pas nager (eau profonde = échec instantané) et ne grimpe pas façon San Andreas: les toits se négocient plutôt en deux-roues. Pas d’avions pilotables, et les hélicos restent surtout l’affaire de glitchs et d’astuces. Les étoiles de recherche reviennent, l’arsenal est connu (SMG, fusils à pompe, carabines), et des bécanes comme la PCJ-600 changent assez le tempo pour que ce «Liberty City d’avant» paraisse neuf en 2005.
Sur PSP, sept modes ad hoc recyclaient modèles et PNJ du solo en deathmatch et poursuites sous stéroïdes. Ces modules ont disparu des ports ultérieurs, mais le cœur solo n’a pas bougé: une carte compacte, des chaînes de missions très denses et des visages familiers qu’on recroise avec un sourire en coin – on sait déjà qui ils deviendront en 2001.
Histoire et casting (l’ascension de Toni, les trois familles, la piste sicilienne)
Le ton lorgne plus du côté des vignettes amères de GTA III que des néons flamboyants de Vice City. Antonio «Toni» Cipriani revient à Liberty City après quatre ans d’exil pour avoir descendu un «made man». Don Salvatore Leone l’accueille… puis l’attache à Vincenzo «Lucky» Cilli, petit chef jaloux qui voit dans l’ambition un crime de lèse-majesté. JD O’Toole, opportuniste chez les Sindacco, commence à balancer des tuyaux pendant que Toni fait tomber les clubs rivaux. Vincenzo le piège, Toni s’en sort, coupe les ponts et poursuit l’ascension. JD veut se faire adouber chez les Leone; Salvatore répond à la loyauté conditionnelle de la manière forte.
Plus haut, l’adjoint sicilien Massimo Torini tire des fils pour que le triangle Leone–Sindacco–Forelli s’entre-dévore. Les tributs se tarissent, les frontières se floutent. La mère de Toni (Ma Cipriani) le couvre de honte pour son «petit grade» au point de commander un contrat sur son propre fils – tragédie comique 100% GTA. Maria Latore, femme-trophée de Salvatore, et Donald Love, magnat aux dents longues, entrent en scène. Plus tard, Toni renverse avec Love l’échiquier de l’urbanisme après un boum autour de Fort Staunton qui transforme les gravats en «terrains de rêve».
À mi-parcours, Toni devient «made man» chez les Leone. La rivalité avec Vincenzo culmine dans une embuscade ratée – Vincenzo finit à la morgue. Les Leone poussent Donald Love vers la mairie, mais la lumière du jour tue l’opération: opinion publique et presse laminent ses chances, ses finances s’effondrent, Miles O’Donovan rafle l’élection. Salvatore est arrêté; Toni reste loyal des deux côtés des barreaux et règle plusieurs dossiers – dont Paulie Sindacco. Sur le versant yakuza, Toshiko Kasen engage Toni pour saborder l’empire de son mari Kazuki. Mission accomplie, issue tragique: Toni abat Kazuki, Toshiko ne supporte pas la culpabilité. Ned Burner, charognard cathodique, tente de faire carrière sur les crimes de Toni – mauvaise idée, courte carrière.
Le final fait tomber les dominos siciliens. Torini est démasqué en architecte de la guerre des gangs, des tripatouillages électoraux et de l’arrestation de Salvatore. O’Donovan est enlevé pour l’empêcher d’abandonner les charges; Toni et Salvatore le libèrent, règlent le compte de Torini au phare et appuient là où la politique écoute vraiment. Le parrain sicilien rentre sur son île, et de facto les Leone tiennent Liberty City. Salvatore promeut Toni – caporegime, là où cette opéra mafieux devait l’emmener. Bonus préquel: plusieurs figures de GTA III reviennent en version «jeune» – Salvatore Leone (Frank Vincent), 8-Ball (Guru) et Ma Cipriani (Sondra James) gardent leur voix, tandis que Toni (Danny Mastrogiorgio), Maria (Fiona Gallagher), Ray Machowski (Peter Appel) et Donald Love (Will Janowitz) sont recastés – joli réglage de la bande-son d’époque.
Réception, ventes et héritage (critiques, prix, classements)
Au lancement, Liberty City Stories a convaincu à la fois la presse et le public. Sur PSP, les notes flirtent avec l’excellence et les moyennes tournent haut – d’un côté, on hallucine qu’une ville vivante tienne dans la poche; de l’autre, on pointe des limites très plateforme: pas de nage, pas d’escalade, quasi pas d’aérien. Le portage PS2 s’en sort un peu moins bien – arrivée tardive et features rognées – mais le tarif plus bas gomme une partie de la déception.
Les chiffres ont tranché. La version PSP s’est installée très vite dans le haut des charts portables américains, devenant la référence des discussions «jusqu’où peut aller un jeu nomade?». La version PS2 a dépassé le million aux États-Unis, pendant que le Royaume-Uni décerne double-platine (PSP) et platine (PS2). Au printemps 2008, le cumul mondial est solidement multimillionnaire – du jamais-vu pour un GTA portable.
Côté récompenses, c’est propre: nomination au «Handheld Game of the Year» lors de la 9e cérémonie de l’AIAS – statuette finalement pour Nintendogs, symbole d’un marché portable 2005–2006 aussi vaste que chaotique. En rétrospective, LCS est salué pour son préquel pensé comme du world-building plutôt que du fan service: ponts inachevés, quartiers en transition, germes de scandales futurs… et surtout, un design qui vous fait jouer ces états de la ville plutôt que de les raconter.
En une ligne: Liberty City Stories a prouvé que l’expérience GTA «grand format» survit à la réduction – si l’on coupe intelligemment et qu’on protège l’essentiel. Moteur maison, optimisation chirurgicale, mix radio au cordeau, missions montées au millimètre et trajectoire de Toni Cipriani composent cette impression de ville qui vit au creux de la main. Et quand une poursuite à moto se termine sur deux étoiles qui bipent pendant qu’un énervé de la FM s’écharpe sur les horaires du ferry, on se souvient pourquoi, en 2005, ça ressemblait à l’avenir: un monde de salon distillé pour le trajet, compromis assumés, mais un vrai cœur qui bat.
– Gergely Herpai « BadSector » –