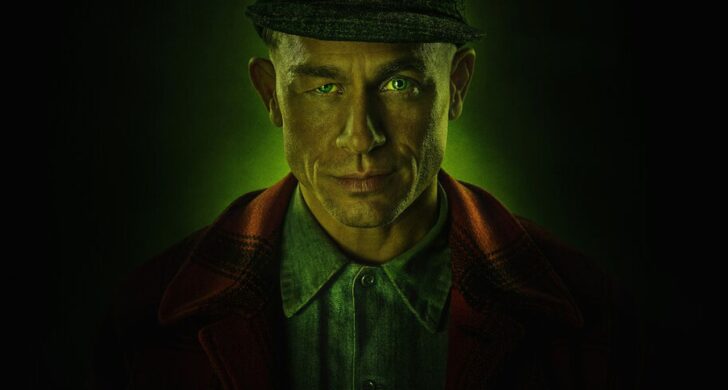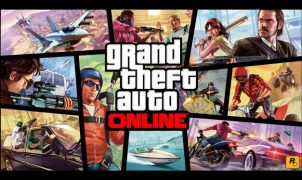ACTUALITÉS CINÉMA – À l’ère du tout-streaming, Netflix a transformé des figures comme Ed Gein en personnages à binge-watcher, brouillant au passage notre vision de la psychologie ; la « psychopathie » a envahi les écrans, et les experts alertent sur des effets bien plus profonds qu’on ne le pense.
Cette fascination ambivalente pour des criminels célèbres n’est pas nouvelle, mais elle vit son âge d’or : le streaming a hissé d’anciens titres de faits divers au rang de sous-genre pop, où des noms comme Ted Bundy et Ed Gein occupent le devant de la scène.
Le problème ne tient pas qu’à la banalisation. Le terme « psychopathe » est devenu une étiquette passe-partout. Or les spécialistes rappellent qu’il n’a jamais été un diagnostic indiscutable ; sa vulgarisation, nourrie par le goût du macabre et les stéréotypes, fausse les prises en charge et même les décisions de justice.
Sur le plan clinique, le « psychopathe » du grand public n’est pas un terme précis. La catégorie la plus proche est le trouble de la personnalité antisociale (TPA), qui évalue plusieurs paramètres : le contexte de vie, l’évolution des schémas dans le temps et, surtout, l’âge d’apparition. De manière générale, si les manifestations n’apparaissent pas avant 15 ans, on ne cadre pas avec le tableau classique.
Le risque s’amplifie lorsque cette étiquette entre au tribunal, portée par la marée des livres, podcasts, films et séries true crime. Comme l’indique le chercheur de l’Université de Toronto Rasmus Larsen, des études sur des jurys simulés montrent que l’emploi du mot « psychopathe » accroît la perception de dangerosité et durcit les peines au-delà de ce que justifient les preuves.
À scénario identique, le dossier étiqueté est plus sévèrement sanctionné – parce que le mythe d’un « mal biologique » s’est incrusté dans l’imaginaire collectif. Paradoxalement, malgré l’exposition médiatique permanente, des exemples comme celui de Larsen révèlent combien notre connaissance réelle du phénomène demeure limitée.
Source : 3DJuegos