TEST – Avec Keeper, Double Fine prouve à nouveau comment polir l’« étrange » pour le rendre attachant : une aventure volontairement simple mais d’un charme désarmant, dont la sensibilité artistique se glisse sous la peau — et n’en sort plus.
Pas de préambule ni d’auto-justification : Keeper parle de lui-même. Double Fine fait ce qu’il maîtrise le mieux — livrer une expérience compacte, facile à appréhender, mais subtilement stratifiée, qui mise moins sur l’avalanche de mécaniques que sur l’ambiance, le rythme et les petits gestes. Dès les premières minutes, on comprend que le jeu ne veut pas tout faire ; il vise la perfection des quelques éléments qu’il assume : un voyage allégorique avec un phare singulier et le compagnon qui niche au sommet.
« Bizarre » ? Plutôt résolument singulier
La patte Double Fine saute aux yeux dès les premiers plans : rien de tapageur, tout est maîtrisé, sans perdre en identité. La palette ne crie pas ; elle murmure — des tons qui se fondent, des teintes volontairement « décalées » qui dessinent les décors. La densité des jungles et les littoraux rongés par la rouille se répondent comme deux genres qui se rencontrent à mi-chemin : l’idylle et la ruine se renforcent mutuellement. Le jeu est court — environ quatre heures et demie — mais son univers visuel est si dense qu’on a souvent envie de mettre en pause pour « regarder ».
Côté technique, le choix est cohérent : pour viser 60 images/seconde, mieux vaut activer un upscaler (DLSS/FSR). Sans cela, la présentation penche vers un rendu plus cinématographique et une cadence plus basse. Ce n’est pas un défaut, mais une préférence : la direction artistique et la caméra se marient bien avec ce rythme « lent », même si les amateurs de fluidité absolue privilégieront l’upscaling.
Créatures et peuples partagent un langage visuel unifié : baleines étranges, petits autochtones, « sourcils » métalliques enroulés autour de la lentille du phare — tout appartient à la même phrase. Brindille, le compagnon, n’est pas un simple faire-valoir : ses mouvements et sa curiosité imprévisible insufflent une vraie vie au monde surréaliste. L’audio suit la même richesse mesurée : la musique de David Earl privilégie des textures adaptées aux scènes plutôt que des thèmes tapageurs, de l’ambient à des couleurs plus brutes, proches de la guitare — sans jamais chercher le projecteur.
Parle sans mots — et joue intelligemment avec ses systèmes
Keeper est silencieux, mais jamais muet. Le faisceau du phare n’est pas décoratif ; c’est une action : il ouvre des passages, fait pousser, apaise les menaces. Le récit se compose en mosaïque — indices subtils et courtes cinématiques qui orientent sans sur-explication. Au centre : endurance et attachement — deux êtres sans voix qui, par leurs gestes, finissent par tout se dire.
La meilleure idée, c’est la manière dont l’arrière-plan du monde arrive via les récompenses. Les statues à collectionner et leurs textes ne sont pas de simples cases à cocher ; ce sont des fragments qui recontextualisent lieux et événements. Rares sont les jeux qui utilisent le système d’achievements comme un ressort narratif organique ; ici, cela coule de source : découverte et « compréhension » avancent de concert.
Un peu court et trop facile pour les vétérans, mais excellent quand même
Sans spoiler : le jeu repose sur deux piliers. Le phare « jardine » avec la lumière — il fait pousser des ponts, dégage des sentiers, creuse des ouvertures sûres — tandis que Brindille gère les tâches fines, proches de l’adresse : déplacer, activer, relier. Les énigmes ne sont pas complexes, le rythme ne vous malmène pas ; le jeu préfère que vous voyiez et ressentiez plutôt que de rester bloqué de longues minutes. Même l’idée de bascules temporelles (changer d’époque via des interrupteurs) orne la progression au lieu de l’alourdir.
Conséquence : on en redemande. Les quatre heures et demie défilent, et l’on aimerait prolonger le tête-à-tête avec la tour et l’oiseau — et une poignée d’énigmes auraient pu mordre davantage. L’envers de la médaille, c’est un format idéal pour jouer « à deux » : se passer la manette, co-naviguer, discuter de ce que l’on voit. Si vous cherchez un défi musclé, vous resterez peut-être sur votre faim ; si vous visez un voyage épuré et émotionnel, vous obtiendrez exactement cela.
-Herpai Gergely BadSector-
Atouts :
+ Direction artistique cohérente et affirmée, efficace sur chaque lieu
+ Concept de héros audacieux : un phare et un compagnon silencieux qui « vivent »
+ Textures musicales variées et adaptées aux scènes, jamais envahissantes
Faiblesses :
– Durée courte — ce monde mériterait plus de temps
– Énigmes rarement exigeantes
– Un 60 i/s stable profite de l’upscaling ; en natif, ce n’est pas toujours maintenu
Développeur : Double Fine Productions
Éditeur : Xbox Game Studios
Genre : Aventure, réflexion (troisième personne, axé atmosphère)
Date de sortie : 17 octobre 2025.
Black Phone 2
Direction - 8.2
Acteurs - 7.4
Histoire - 7.5
Visuels / Ambiance horrifique - 8.2
Ambiance - 7.8
7.8
BON
Derrickson mène Black Phone 2 en slasher de demi-sommeil, confiné dans un camp en congélation, où les chocs secs cèdent la place à une peur qui s’infiltre. Le Rôdeur d’Ethan Hawke demeure un emblème glaciaire : un seul sourire, et le sang se fige. Le film cherche la paix pour Finney et Gwen tout en entrouvrant la porte à un prochain appel.







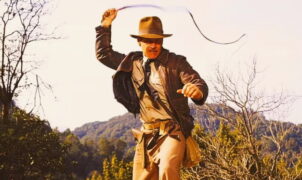









![[TGA 2025] Resident Evil Requiem mise sur Leon pour un retour à deux visages [VIDEO]](https://thegeek.site/wp-content/uploads/sites/3/2025/12/theGeek-Resident-Evil-Requiem-Leon-S-Kennedy-300x365.jpg)